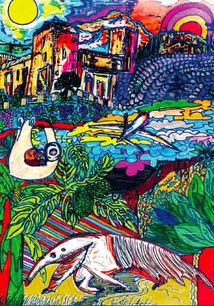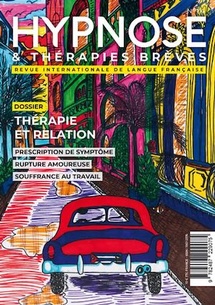DES ORIGINES AUX THÉORIES SUCCESSIVES.
Dès l’Antiquité, la sympathie précède l’empathie. Hippocrate et Aristote y voient la résonance pathologique entre les organes du corps, parlant de sympathie entre ces derniers. La sympathie, c’est d’être affecté par les souffrances du prochain, c’est comme une corde tendue entre deux individus sur laquelle on peut créer une vibration commune. Après avoir été définie en 1759 par Adam Smith, puis en 1800 par Pierre-Jean- Georges Cabanis comme l’opérateur essentiel des rapports entre les hommes, la sympathie va tendre vers des débats esthétiques jusqu’à désigner un sentiment d’attirance, pour quelqu’un ou quelque objet. De cette autonomisation esthétique, c’est un nouveau terme qui va surgir en 1873 par le philosophe allemand Robert Vischer, l’« Einfühlung », dont la traduction sera l’« empathie ».
En 1909, Theodor Lipps effectue un transfert de ce concept, de l’esthétique vers la psychologie. Il remarque qu’en observant un funambule sur sa corde, on ne peut s’empêcher d’imiter certains de ses mouvements se succédant, de perte et de rétablissement d’équilibre. L’empathie se réfère ainsi à une imitation « suspendue » comme si nous simulions intérieurement et instinctivement un acte, voire même une émotion. La psychanalyse s’empare de l’empathie, avec Sigmund Freud qui la compare au principe d’imitation, mais en précisant que c’est comme si on accompagnait sans que l’imitation soit effectuée. Il précise que dans une cure, il faut maintenir cette Einfühlung, sans moraliser, sans prendre parti, en restant juste dans cette attitude empathique, un long moment parfois ; comme une patience requise pour éviter des interprétations prématurées ; comme une condition préalable à l’analyse ; comme il l’a fait pour pénétrer les modes de pensée de l’homme aux loups. Sándor Ferenczi le rejoint dans cette idée, mais adjoint le mot « tact » à l’empathie, comme condition et temporalité à la fois, pour permettre de se mettre au diapason de l’autre, de sentir avec. S’il peut y avoir une forme d’élasticité quant à leurs modes d’emploi respectifs de l’empathie, tous deux reconnaissent que celle-ci suppose une neutralité dans la proximité affective, car il y a bien de l’affect dans cette façon d’être.
D’un moyen de connaissance d’autrui pour Lipps ou pour Freud, l’empathie devient le fondement de la connaissance objective à travers l’intersubjectivité décrite par Husserl, pour qui l’altérité du semblable va arracher l’homme au solipsisme, pour le conduire à celle-ci, seul chemin possible vers un monde objectif. Sa pensée sera reprise dans la phénoménologie de la perception de Merleau- Ponty où l’accent est mis sur l’expérience du corps vécu. Paul Ricoeur, au travers d’une philosophie du langage, y adjoint la distance à poser, dans une profonde valeur éthique, avant même d’accorder à l’empathie un rôle premier dans la constitution de l’identité narrative ; une identité où l’individu ne se résume pas à la succession des différents états de son esprit et son corps ; une identité dont la compréhension réside dans la faculté de se mettre en position méta et d’observer les actions et les émotions qui s’en dégagent, pour les laisser s’organiser dans cette causalité spécifique qu’il appelle narrative. Carl Rogers, inspiré par une phénoménologie plus proche de Soren Kierkegaard, a joué un rôle important par la diffusion de l’empathie dans le champ des psychothérapies et du counseling, en la définissant comme un moteur de transformation attendu par un traitement psychothérapique. Dans une démarche empathique, le thérapeute perçoit le cadre de référence interne du « client » comme s’il était le « client », sans jamais perdre de vue la condition du « comme si », afin de ne jamais se perdre dans l’identification. Pour lui ce ne sont pas des concepts à appliquer, mais plus un savoir-être dans un souci permanent de congruence.
Heinz Kohut renforce le rôle dévolu à l’empathie en l’affirmant plus dans la connaissance que dans la réparation, comme une introspection par procuration étendue à autrui, une introspection vicariante, qui précède l’insight qui lui est subordonné (l’insight en psychologie cognitive est le niveau de conscience du trouble). A ce moment, tous s’accordent à reconnaître à l’empathie deux dimensions : une dimension affective, et une dimension cognitive. Ces deux dimensions s’expliquent tour à tour aussi bien au travers de la psychologie comportementale et cognitive, qu’au progrès des neurosciences depuis la fin du XXe siècle. La composante affective fait lien avec la résonance motrice non intentionnelle produite par les neurones miroirs découverts par Giacomo Rizzolatti, mais aussi avec l’universalité des six émotions primaires de Paul Eckman, perçues, ressenties et exprimées de façon équivalente chez tous les humains.
OBSERVATION DES NOUVEAUX-NÉS ET ÉVEIL EMPATHIQUE...
Ce mimétisme de résonance motrice, tout comme ces émotions partagées expliquent les phénomènes de facilitation sociale, ainsi que la contagion émotionnelle susceptible d’atteindre certains sujets trop empathiques envers d’autres ; particulièrement si cette composante affective prédomine sur l’autre composante, spontanément propice à la contagion émotionnelle, ou consécutivement à une altération de la composante cognitive comme dans les démences fronto-temporales. Cette capacité d’imitation que l’on retrouve dans la composante affective est en quelque sorte innée puisque l’observation des nouveaux-nés nous montre qu’ils possèdent dès le début de la vie cette possibilité de partage d’affect jusqu’à la contagion émotionnelle. Rapidement, ils développent des capacités d’identification et de discrimination du soi-autrui, appelé l’éveil empathique. Peu de temps après la naissance, en effet, le nouveau-né réagit différemment aux pleurs du nouveau-né du même âge, aux pleurs d’un adolescent, aux pleurs d’un bébé chimpanzé, voire à ses propres pleurs. Il ne pleure véritablement que s’il discrimine les pleurs de ses congénères du même âge. Dans les interactions de la mère avec son bébé, validant les théories d’André Green dans son concept de « la mère morte », en référence à l’effet structurant du regard maternel de Donald Winnicott, l’expérience où la mère montre un visage immobile, qui lui est imposé, qui engendre un immense malaise chez son bébé. Un nourrisson est impatient et avide du lien constitué au travers de l’imitation du visage de sa mère, y cherchant une reconnaissance mutuelle d’empathie. Tout porte à penser que le nouveau-né est déjà pourvu de pré-réseaux neuronaux de l’empathie, car dès la deuxième année de vie, il ajoute le souci de l’autre à sa construction de l’empathie.
NEUROSCIENCES ET LANGAGE EMPATHIQUE.
Ces théories sont modélisées par les découvertes des neurosciences, précisant les régions cérébrales concernées. De façon schématique, l’empathie émotionnelle est liée au registre du système limbique, incluant l’hypothalamus et le cortex parahippocampique, l’amygdale et d’autres régions comme l’insula et une partie du cortex préfrontal, quand l’empathie cognitive est liée au système du réseau exécutif impliquant préférentiellement le cortex frontal médian et fronto- temporal et le cortex cingulaire antérieur. La dimension cognitive de l’empathie est définie par Jean Decety comme la perception supplémentaire chez l’homme de percevoir l’autre comme un agent intentionnel, avec une capacité d’épouser, ou pas, sa perspective subjective. Decety l’appelle la reconnaissance et la compréhension minimale des états mentaux d’autrui, avec sa capacité discriminative de la distinction entre soi et l’autre, au-delà du partage affectif. Au travers de l’ontogénèse de l’empathie, nous constatons que, par le langage, l’enfant va progressivement comprendre vers l’âge de 4 ans que l’autre peut avoir des perceptions différentes de lui-même, sur les choses extérieures que lui voit à sa façon propre, dans sa quête de représentation du monde de l’autre. Nous pouvons avancer que le langage est facilitateur de la construction de l’empathie cognitive en liaison à la maturation de ses fonctions exécutives dont nous avons parlé. Il y a lieu d’insister sur ce pouvoir du langage par lequel nous opérons dans nos pratiques, que ce soit la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales, et toutes les autres thérapies brèves en passant par l’hypnose.
L’observation des nouveaux-nés nous montre qu’ils possèdent dès le début de la vie cette possibilité de partage d’affect jusqu’à la contagion émotionnelle. L’empathie se caractérise ainsi par ses deux composantes primaires : • une réponse affective envers autrui qui implique parfois un partage de son état émotionnel ; • une capacité cognitive de comprendre la perspective subjective de l’autre. Mais avec une barrière majeure, celle de ne pas prendre la place du patient, car selon la réponse prêtée à Jacques Lacan : « Et où voulez-vous que le patient soit, alors ? » Il est essentiel de le laisser dans son récit narratif en lui montrant juste qu’on est là, près de lui, mais sans être lui, tout en le comprenant dans ses affects, dans son discours. Par notre capacité d’empathie cognitive, qui rejoint celle du patient, on est dans la compréhension de son esprit. Et cela encore une fois grâce à ce langage empathique, qui dans sa spécificité traite l’autre comme égal à nousmêmes. Un langage qui se pratique avec tact, parfois de façon métaphorique. Il reste un excellent moyen de communiquer pour savoir quel est sentiment de l’autre, mais sans réelle certitude, car comme le rappelle Ludwig Wittgenstein, les mondes intérieurs sont incommunicables si on n’y adjoint pas le langage ; dans l’exemple de son célèbre récit du scarabée dans la boîte, où schématiquement la boîte est notre conscience, et le scarabée un des contenus. A travers le langage et l’échange, nous savons, sans certitude, que l’autre a un scarabée dans sa boîte, mais sans savoir réellement comment il est... Ainsi dans la relation empathique, l’autre est perçu comme l’alter ego, c’est-à-dire un autre moi, à la fois commun et différent.
L’EMPATHIE DANS LA RELATION THÉRAPEUTE-PATIENT.
Eu égard à la construction neurologique d’une empathie émotionnelle et d’une empathie cognitive, Julie Grèzes décrit cette dernière comme la constitution du self qui doit être bien finalisée pour que l’empathie puisse agir. Pour nous thérapeutes…
Pour lire la suite...
Dr Olivier de Palézieux
Ses publications : « Dossier Hypnose et méditation », « Hypnose & Thérapies brèves » n°56 ; « Construction contemporaine de la méditation et de l’hypnose au travers des neurosciences »,
« Hypnose & Thérapies brèves » n°57 ; Mémoire « Hypnose et méditation : une alliance thérapeutique ? »,
université de Paris-Saclay, 2019.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°74 version Papier
La puissance thérapeutique de la relation humaine
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :
Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.
. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.
. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.
. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.
. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.
. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par, Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.
. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation ».
. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet. .
A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.
. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).
Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit ».
. Livres en bouche du mois.